L’IA, une technologie de rupture ?
Cette expression, dérivée de l’anglais disruptive innovation, a été introduite par le Pr Christensen en 1997 pour désigner toute technologie susceptible de remplacer une technologie dominante (1). Dans notre environnement, les exemples sont nombreux, à l’image des écrans LED qui ont relégué les tubes cathodiques de notre enfance au rang de vestiges. En radiologie également, il n’est pas rare de voir des nouvelles technologies totalement supplanter des plus anciennes. Les films argentiques ont disparu au profit des Écran Radioluminescent à Mémoire, eux même remplacés progressivement par les capteurs plans. La question se pose donc : l’IA est-elle une technologie de rupture et, si oui, quoi ou qui remplacera-t-elle ?
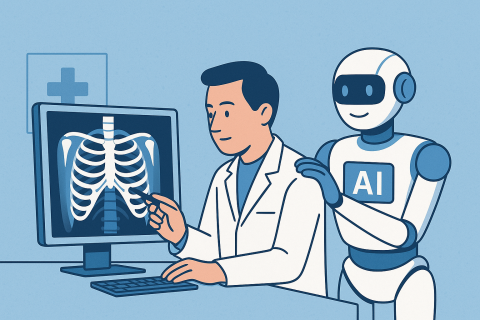
Image générée par Chat GPT
L’IA est aujourd’hui présente à toutes les étapes du parcours de soins, du diagnostic au traitement. Concernant le diagnostic, de nombreuses solutions sont déjà bien implantées dans nos services, à l’instar des outils d’aide au diagnostic en mammographie ou des systèmes de détection de fractures aux urgences (2,3). Sur le plan thérapeutique, en radiothérapie par exemple, par les solutions d’aide au contourage qui permettent un gain de temps et une meilleure standardisation des pratiques (4). L’intégration de l’IA ouvre ainsi la voie à une transformation majeure du secteur médical. Elle automatise les tâches routinières et optimise la précision des diagnostics. Une revue de littérature publiée dans The Lancet en 2024 a démontré que l’utilisation de l’IA en pratique clinique permet une amélioration significative de la gestion des soins et de la prise de décision (5). De nombreuses autres études suggèrent même que les modèles d’IA médicale peuvent égaler, voire surpasser, les cliniciens dans diverses spécialités (6).
La question se pose alors de confier un rôle décisionnaire aux algorithmes d’IA. Cette idée mérite d’être nuancée, pour au moins trois raisons.
Premièrement, les méthodologies de recherche employées qui permettent d’affirmer les performances des algorithmes mériteraient d’être renforcées, ce qui, dès lors, appelle à une certaine prudence (7). Une validation rigoureuse par des essais cliniques robustes reste aujourd’hui un prérequis indispensable à leur implémentation sécurisée dans les pratiques, ce qui, dans les faits, n’est pas toujours possible. (5) Deuxièmement, le cadre législatif actuel ne le permet pas. Au niveau européen, l’IA ACT, entrée en vigueur en 2024, impose des obligations spécifiques à l’utilisation de ces systèmes. Restrictive selon les uns, protectrice selon les autres, elle vient fixer un cadre à leur utilisation au sein de l’UE. La supervision humaine est rendue obligatoire afin d'éviter une automatisation aveugle des décisions, excluant dès lors le principe de technologie visant à remplacer les professionnels. La loi française vient appuyer ce fait : l’établissement d’un diagnostic ou d’une prescription relève de l’entière responsabilité du médecin. Enfin, d’un point de vue éthique, dans une discipline où la relation patient-soignant se doit d’être la plus équilibrée possible, l’IA ne saurait se substituer à ce binôme dans le processus de décision thérapeutique. Telle une boussole, elle pourra guider, proposer, conseiller, mais non décider. Dans le binôme radiologue-manipulateur également, elle pourra soutenir l’émergence d’une réflexivité commune dans les cas complexes.
Conclusion
Déjà bien implantée en radiologie, l’IA s’annonce comme un outil incontournable. À l’image des algorithmes de reconstruction qui améliorent les images sans remplacer l’acquisition, elle accompagne les professionnels sans supplanter leur expertise. Son déploiement doit cependant s’accompagner d’une vigilance constante, tant chez les médecins que chez les manipulateurs. Plus qu’une technologie de rupture, l’IA apparaît aujourd’hui comme une technologie d’accompagnement, au service d’un soin toujours plus précis et humain.
Axel BEASSE
Cadre formateur, IFMEM du Centre Hospitalier Sud Francilien
Institut des Formations Paramédicales du GHT Ile de France Sud, Corbeil-Essonnes
Références
1. Christensen C. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail [Internet]. Harvard Business School Press; 1997 [cité 28 mars 2025]
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=46
2. Yoon JH, Strand F, Baltzer PAT, Conant EF, Gilbert FJ, Lehman CD, et al. Standalone AI for Breast Cancer Detection at Screening Digital Mammography and Digital Breast Tomosynthesis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Radiology [Internet]. 23 mai 2023 [cité 28 mars 2025]
https://doi.org/10.1148/radiol.222639
3. Kuo RYL, Harrison C, Curran TA, Jones B, Freethy A, Cussons D, et al. Artificial Intelligence in Fracture Detection: A Systematic Review and Meta-Analysis. Radiology. juil 2022;304(1):50‑62
https://doi.org/10.1148/radiol.211785
4. Doolan PJ, Charalambous S, Roussakis Y, Leczynski A, Peratikou M, Benjamin M, et al. A clinical evaluation of the performance of five commercial artificial intelligence contouring systems for radiotherapy. Front Oncol [Internet]. 4 août 2023 [cité 28 mars 2025];13
https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1213068
5. Han R, Acosta JN, Shakeri Z, Ioannidis JPA, Topol EJ, Rajpurkar P. Randomised controlled trials evaluating artificial intelligence in clinical practice: a scoping review. Lancet Digit Health. 1 mai 2024;6(5):e367‑73
https://doi.org/10.1016/S2589-7500(24)00047-5
6. Robert C, Meyer P, Séroussi B, Leroy T, Bibault JE. Artificial intelligence and radiotherapy: Evolution or revolution? Cancer/Radiothérapie. 1 nov 2024;28(6):503‑9
https://doi.org/10.1016/j.canrad.2024.09.003
7. Liu X, Faes L, Kale AU, Wagner SK, Fu DJ, Bruynseels A, et al. A comparison of deep learning performance against health-care professionals in detecting diseases from medical imaging: a systematic review and meta-analysis. Lancet Digit Health. 1 oct 2019;1(6):e271‑97
https://doi.org/10.1016/S2589-7500(19)30123-2
